2. L'expérimentation de Picasso avec les doutes de Cézanne : quinze façons « d'aller sur le motif ».
Picasso aimait dire que Cézanne « était notre père à tous",[1] où « tous » faisait référence aux artistes qui, au début du XXe siècle, voulaient révolutionner la peinture pour qu'elle cesse de représenter et commence à présenter, laissant la tâche mimétique à la photographie.
Le 23 octobre 1906, trois mois après le séjour de Picasso à Gósol, Cézanne mourut d'une pneumonie, juste un an avant la grande rétrospective de son œuvre au Salon d'Automne à Paris. Avant cela, Picasso « connaissait depuis longtemps l'œuvre de Cézanne »;[2] il avait déjà vu des dizaines de Cézanne originaux dans les Salons d'Automne successifs depuis 1904, dans l'arrière-boutique de la galerie Vollard (Vollard était le marchand d'art de Cézanne et, par la suite, de Picasso)[3] et chez les Stein. Sa prodigieuse mémoire visuelle a retenu ces œuvres comme l'esprit retient un apprentissage cryptique à l'attente de son moment d'émergence et de lucidité.
J'affirme que ce moment est le voyage à Gósol durant l'été 1906, bien que Picasso ne se soit pas consacré à peindre le Pedraforca (le principal massif de Gósol et le plus impressionnant de Catalogne) comme Cézanne a peint la montagne Sainte-Victoire. Comme je l'ai déjà évoqué, cette influence n'est généralement pas reconnue par les autres spécialistes, qui considèrent comme établi qu'à l'été 1906, Picasso était plutôt plongé dans une sorte de primitivisme gauguinien.[4] Cependant, je pense que l'aspect gauguinien se retrouve essentiellement dans les périodes bleue et rose. Depuis les premières tentatives de création[5] du Portrait de Gertrude Stein, Gauguin n'apportait plus aucune solution et Picasso décide, poussé intellectuellement par Gertrude, de suivre les pas anxieux de Cézanne.[6] Cela l'a obligé à adopter l'idéal sceptique d'un abandon programmatique de toute habitude, dogme ou geste habituel établi.
Rien n'est plus éloigné du dogme que les options plastiques de Cézanne, construites à partir d'un doute permanent et dans un processus de réflexion sans fin ; avec lui, la peinture a appris à montrer ses propres échecs dans une sorte de dialectique négative que l'on retrouve souvent dans la peinture moderne la plus avancée.[7] Cézanne a prétendu être l'initiateur primitif d'un nouvel art, et il y est parvenu avec peu d’emphase, des gestes simples et de petites toiles. Loin du premier modernisme parisien, dans sa Provence natale, chevalet en main et maniant ses pinceaux, il chercha dans la nature ses formes les plus simples : le cylindre, la sphère et le cône. Son originalité, contrairement à celle de Manet, avait la rugosité d'un retour à l'origine, ou à la perception primordiale, comme l'appelle Merleau-Ponty; c'est probablement le meilleur terme pour définir ce que signifie le soi-disant primitivisme artistique dans le processus créatif de Cézanne et celui de Picasso,[8] pourquoi Cézanne se considérait comme le primitif d'un nouvel art et comment sa méthode fonctionnait comme un mantra : ce n'est que par la répétition des gestes que la perfection de la forme simple pouvait être atteinte. Dans cette nouvelle compréhension, les huiles ne seraient plus des œuvres - opera, œuvres finies - mais des événements dans une recherche infinie, comme celle de Frenhofer[9] (l'alter ego choisi par Cézanne, qui a aussi été choisi par Picasso dans ses années de maturité.).
[1] Voir Christian Zervos, « Conversation avec Picasso », dans Cahiers d’art, numéro spécial (1935): p. 173-8), cité dans Bernadac et Michaël (Eds.), Propos : p. 31–6; Daniel–Henry Kanhweiler, « Entretiens avec Picasso au sujet des Femmes d’Alger », Aujourd’hui 4 (septembre 1955), dans Bernadac et Michael (Eds.), Propos, p. 70–4; Brassaï, Conversations avec Picasso (Paris: Gallimard, 1964: p. 104), cité dans Bernadac et Michaël (Eds.), Propos : 104–14 et 148–54, voir en particulier 148–9; François Gilot et Carlton Lake, Life with Picasso, (New York : McGraw-Hill Book Company, 1989 [1964]), p. 68–71; Helène Parmelin, Picasso dit…. (Paris: Gontier, 1966), p. 66; André Verdet, « Picasso et ses environs » dans Entretiens, notes et écrits sur la peinture. Braque, Léger, Matisse, Picasso (Paris: Ed. Galilée, 1978): p. 140-1. Picasso faisait parfois référence à Cézanne comme à « une mère qui protège ses enfants » (cité par Brigitte Léal dans « Le parfum du marbre lointain de la Sainte-Victoire », dans Billoret-Bourdy et Guérin (Eds.), Picasso Cézanne, 56-60; Michel Guérin, « Réalisation et démiurgie », dans Billoret-Bourdy et Guérin (Eds.), Picasso Cézanne : p. 16).
[2] Richardson, A life of Picasso, Vol II, p. 52.
[3] Parmi les tableaux de Cézanne que possédait Vollard et que Picasso a vus en 1904 se trouve Mardi gras (1881), qui a eu une grande influence sur la dimension scénique des peintures à Gósol. La relation entre Vollard et Cézanne est discutée dans : Rebecca A. Rabinow (Ed.), Catalogue Cézanne to Picasso. Ambroise Vollard, Patron of Avant-garde (New York – Paris: The Metropolitan Museum of Art, The Art Institute of Chicago et Musée d’Orsay, Yale University Press et Réunion des Musées Nationaux, 2007). L’influence de Vollard sur l'éducation cézannienne de Picasso est en fait devenue cruciale, comme le montre Anne Roquebert dans « De Cézanne à Picasso. Chez Vollard » dans Billoret-Bourdy et Guérin (Eds.), Picasso Cézanne, p. 31–41.
[4] Richardson, A life of Picasso, Vol II: p. 52.
[5] Il est passionnant de voir ces premiers essais dans les radiographies du visage du portrait, voir Tinterow and Alison (Eds.), Picasso, 115.
[6] Sur la référence de Picasso à « l'anxiété de Cézanne », voir : Zervos, Bernadac et Michael (Eds.), Picasso, 178. Voir aussi Éric Bonnet, « Écrire et détruire les figures », dans Billoret-Bourdy et Guérin (Eds.), Picasso.: p. 45–54, en particulier la p. 49. Au sujet de l'influence intellectuelle de Stein qui a poussé Picasso à se tourner vers Cézanne, voir Madelaine, « Préface », Gertrude Stein, Pablo Picasso, p. 9–11.
[7] Getrude Stein affirma même que : « Toute la peinture moderne est basée sur ce que Cézanne n'a pas réussi à faire, plutôt que sur ce qu'il a presque réussi à faire. Montrer ce qu'il ne pouvait pas réaliser était devenu l'obsession de Cézanne et de ses disciples » (texte cité dans Harold Acton, More memoirs of an Aesthete [London: Methuen, 1970), 175.
[8] Merleau-Ponty, Sens et non-sens, 20
[9] En 1937, Picasso s'installa au même endroit que celui où Balzac établit l'adresse de Frenhofer, voir Ludmila Virassamynaiken, « La lutte d’amour », in Billoret-Bourdy et Guérin (Eds.), Picasso Cézanne: p. 135–48, voir en particulier p. 144–5.
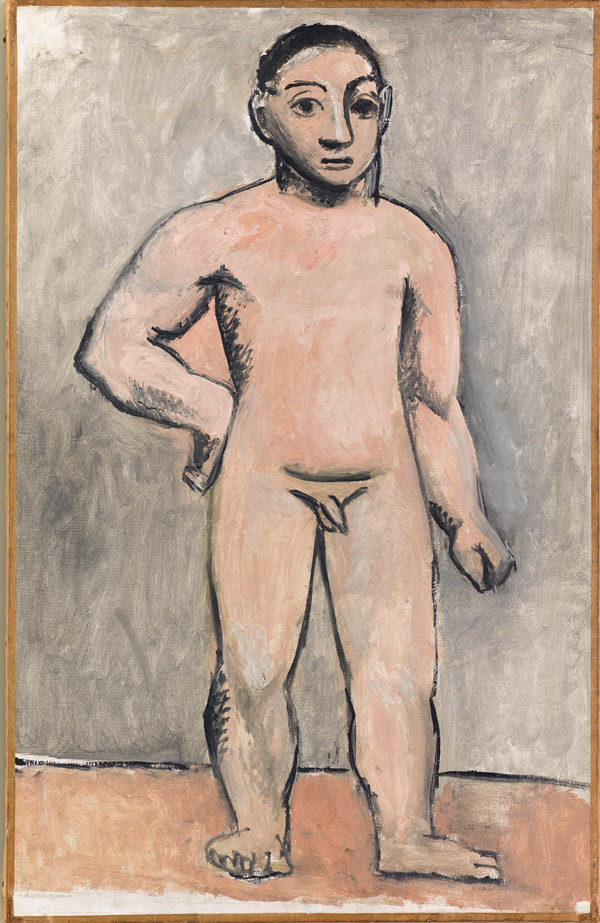




 Sommaire
Sommaire