La fabrique d’une bouteille
Laissons de côté la première approche de ce papier collé dont l’a-signifiance apparente provoque le spectateur. Accéder au savoir en relevant le défi de cette provocation, c’est d’abord parier sur l’existence d’un sens. Observons-donc plus avant cette œuvre.
Face à une juxtaposition d’éléments hétéroclites : feuille de journal, papier vélin découpé et collé, traits au fusain, surface traitée à l’encre de Chine, la première relation, certes très générale, pourrait être celle qui lie spatialement ces éléments.
Picasso exploite les propriétés d’une feuille de journal de 62,5 x 44 cm. La largeur de la feuille est divisible en cinq parties égales dont les trois premières lignes de séparation correspondent à des traits marqués au fusain. De même, la hauteur de la feuille est divisible en six parties égales. Les deux premières lignes sont marquées par des traits au fusain, la troisième correspond au milieu géométrique de la page, et la dernière est à nouveau marquée au fusain. Le quadrillage ainsi obtenu met en place un module.
La hauteur de ce module est reportée plusieurs fois sur une ligne verticale segmentée, à gauche de la composition. Cette ligne segmentée indique aussi une deuxième mesure. Cette mesure correspond à la largeur d’une colonne d’écriture. La ligne segmentée apparaît ainsi comme une échelle indiquant : la largeur d’une colonne de journal, la hauteur d’un module de page, et la distance entre les deux, soit trois mesures. Ces trois mesures permettent de construire l’ensemble des éléments au centre visuel de la composition : hauteur et largeur des figures géométriques, arc des ellipses.
L’ensemble de ces reports met en évidence des zones plastiques autonomes formant chacune une unité. La forme de chacune, leur coprésence et leur agencement régissent leur sémantisme. De haut en bas apparaissent alors une bague, un col (formant ensemble le goulot), une épaule, un cul (ou jable) de bouteille. La zone du corps, même si elle reste situable entre l’épaule et le jable, est plus problématique.
Considérons d’abord le papier collé blanc. En bas, il définit en réserve le jable. Il marque donc l’extérieur du jable de la bouteille, et c’est dans ce sens qu’il est lisible sur toute sa surface, puisqu’aucune indication contraire n’est mise en évidence. Le vélin blanc représente donc l’extérieur de la bouteille au niveau du corps.
Si l’on trace mentalement les parois de la bouteille entre les épaules et le jable, nous obtenons un corps formé par le parallélépipède noir et la partie blanche extérieure. Il faut jouer d’un effet d’optique par un déplacement du spectateur de droite à gauche de l’œuvre, pour voir le plan parallélépipédique noir se dégager de la surface blanche en « tournant » autour d’un axe, et former ainsi l’intérieur du corps de la bouteille. Tout se passe comme si cette zone, en deux dimensions sur l’œuvre, accédait par ce mouvement du spectateur à une existence en volume de l’intérieur de la bouteille.
Revenons sur l’ensemble des opérations effectuées : créer une échelle avec notation de trois étalons. A partir de ces mesures, tracer des lignes et des ellipses proportionnées les unes aux autres, selon une distribution verticale, rabattre les plans de la bague et du jable, et faire pivoter le plan noir. La bouteille est le résultat de cette série d’opérations.
Le Sujet « auteur » fait-faire une série d’instructions au Sujet « spectateur », absolument comme une recette de cuisine ! Cette série d’instructions est analysable en un récit construit sur la dimension pragmatique (la dimension de l’action) : il s’agit d’un guide de montage d’une bouteille.
Puisque nous avons repéré une bouteille, la question qui se pose est simple : quel est l’intérêt de représenter de manière aussi obscure cette bouteille somme toute banale ?
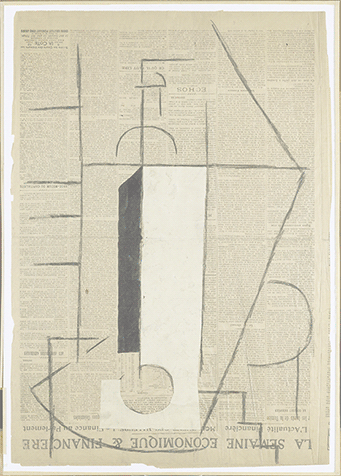
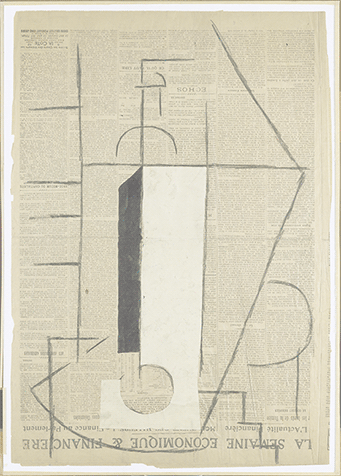




 Sommaire
Sommaire