L’univers de Picasso : une vaste solitude
Jean Cassou n’avait pas ce point de vue critique sur l’œuvre de Picasso, qu’il considérait comme un génie. « On a fait grief à Picasso de ses transformations successives. On y a voulu voir la preuve de son manque d’unité, de son absence de personnalité, de sa faute de génie, de son néant. Il faut n’avoir jamais goûté les amères délices de la profonde et indifférente solitude pour ne pas comprendre que c’est justement ces transformations successives qui révèlent, dans sa solitaire essence, l’unité de Picasso, sa personnalité, son génie, sa réalité.
On parle de l’univers de tel ou tel artiste : c’est le décor familier, le paysage intime qu’il porte constamment avec lui, où il se retrouve, où il se retrempe. Picasso n’a point d’univers. Ou son univers, c’est une vaste solitude, où croissent, pour mourir, de soudaines végétations, ou plus exactement c’est une suite de solitudes qui se métamorphosent l’une dans l’autre, se substituent l’une à l’autre. Et il semble que jamais il n’y ait eu de retour en arrière. »[1]
« J’ai voulu être peintre et je suis devenu Picasso »
Marcel Duchamp disait de lui : « Picasso, avec sa grande vision ce que peut être un peintre aujourd’hui, a pu englober et le cubisme et le surréalisme, et même encore d’autres formes auxquelles nous n’avons pas donné de noms et qui s’appellent Picasso. »[2] Toute sa vie, de son apprentissage académique aux dernières années, l’observation des maîtres du passé, antiques, anciens ou modernes fut un moyen pour lui de confronter son langage pictural aux chefs-d’œuvre, de renouveler d’une façon toute personnelle le genre de la citation, de pousser à l’extrême sa propre introspection. Auteur d’une œuvre immense, que ce soit dans ses travaux très personnels, dans ses variations autour des tableaux de maîtres, dans ses objets du quotidien dérisoires aux destins précieux ou dans ses recherches dont il a laissé la trace, Picasso appartient désormais au patrimoine universel de l’art.
À l’occasion de l’exposition Picasso & Les Femmes d’Alger à Berlin[3], Les commissaires et les auteurs du catalogue ont replacé la série dans un contexte contemporain. Amanda Beresford consacre son essai à l’influence de la série de l’artiste sur les femmes algériennes. Car assez étonnamment, plusieurs autrices ont associé les peintures de Picasso avec leurs propres revendications, leur ressenti par rapport à l’histoire de leur pays, comme une métaphore de l'émancipation des femmes algériennes par la guerre. Une lecture féministe des tableaux de Picasso peut surprendre. Ils seraient, pour elles, « les formes d'expression de l'ancienne culture dominante ». Selon Amanda Beresford, « les autrices s'approprient les tableaux de Picasso en opérant de la même manière que ce dernier : elles colonisent Picasso comme celui-ci a colonisé Delacroix. Tentant de prendre le contrôle sur la signification des peintures de Picasso, elles entendent faire sortir les images et identités de toutes les femmes d'Alger d'une histoire marquée par les mésinterprétations culturelles. Par-là, elles défient l'héritage continu d'un sexisme et colonialisme orientaliste. En se réappropriant Picasso le conquérant, Assia Djebar d'abord, puis Anissa Bouayed et Ranjana Khanna opèrent une telle transformation[4]. » Ce qui est intéressant n’est pas l’interprétation des intentions de Picasso, qui n’est pas le sujet ici, mais bien la façon dont des autrices féministes se sont saisies de son propos. Les œuvres peuvent être très différemment comprises selon les époques où elles sont regardées, analysées et « rechargées de nouvelles significations ».
[1] Jean Cassou, La Création des mondes. Essais sur l’art. Paris, Les Éditions ouvrières, collection « Vivre son temps », 1971, p. 7.
[2] Cité par Bernard Marcadé in « C’est du Picasso ! », Picasso, l’objet du mythe, éditions de l’École nationale supérieure des Beaux-Arts, Paris, p.229.
[3] L’exposition s’est tenue à la Nationalgalerie, Staatliche Museen zu Berlin, du 21 mai au 28 août 2021.
[4] Amanda Beresford, in Picasso & Les Femmes d’Alger, cat. expo, éditions Hirmer, p. 179-181.
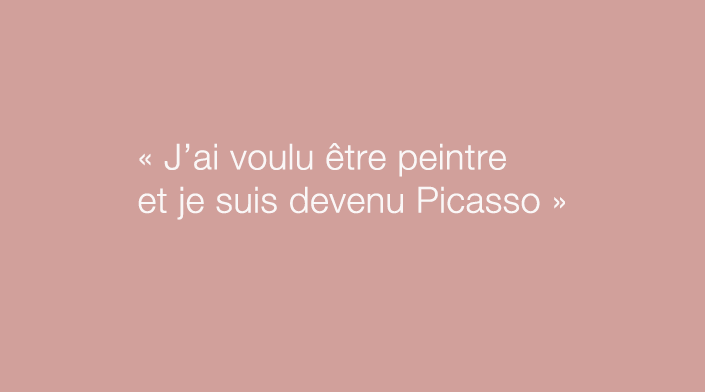




 Sommaire
Sommaire